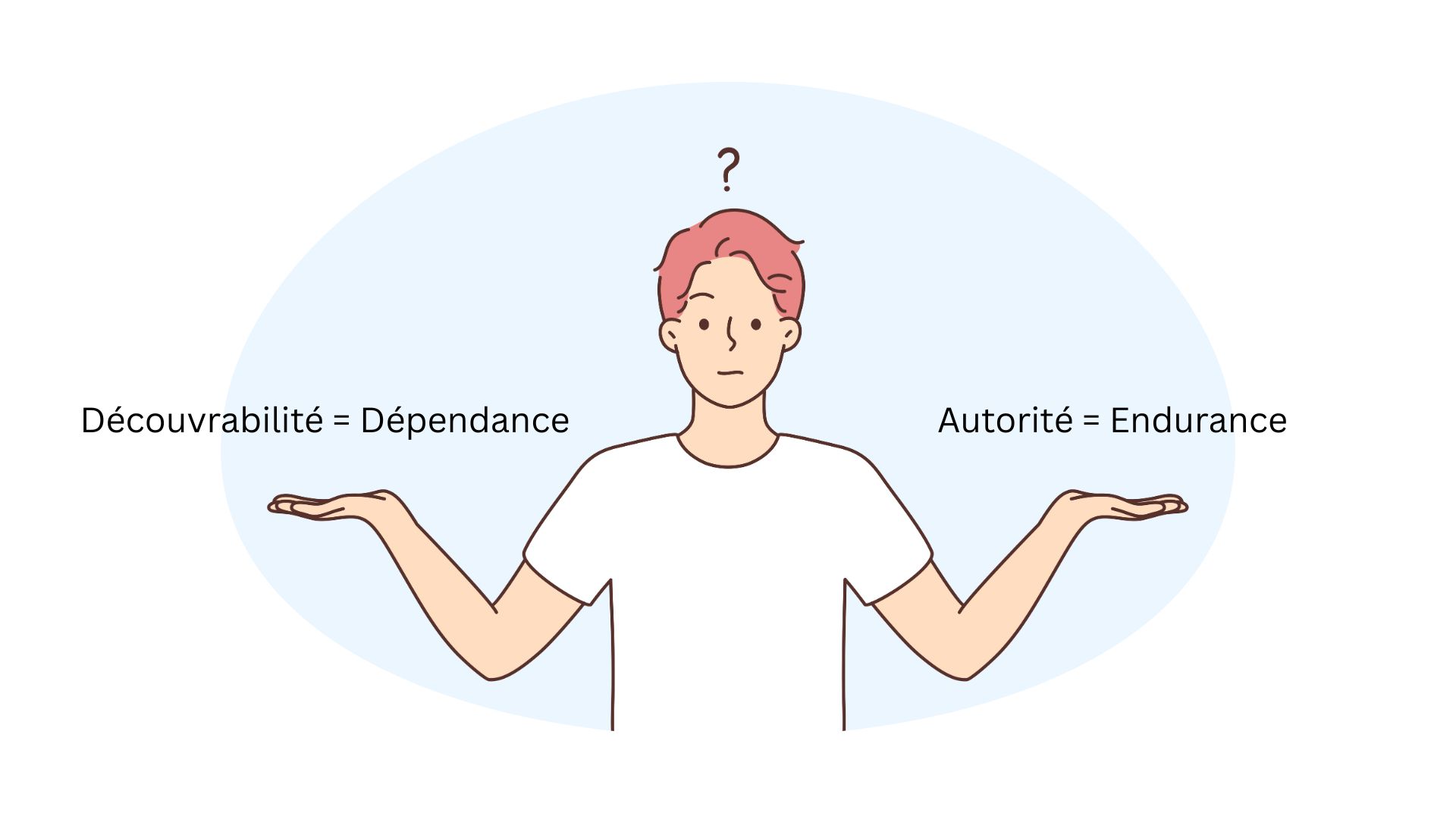Dans les arts, et bien au-delà, de nombreuses organisations restent préoccupées par le défi de la « découvrabilité ». Comment faire en sorte que nos événements apparaissent en ligne? Comment monter dans les résultats de recherche? Comment être présents quand quelqu’un pose une question à ChatGPT, Gemini ou Perplexity? Comment suivre des règles qui changent sans cesse?
Cela semble sans fin. Un ensemble de tactiques est à peine maîtrisé qu’un nouveau virage arrive. À peine une stratégie de classement Google commence-t-elle à fonctionner qu’un nouvel algorithme rebrasse l’ordre. À peine une organisation développe sa capacité sur une plateforme sociale que le public se déplace vers une autre. L’IA générative s’est maintenant invitée dans l’équation et elle retransforme la manière dont la découverte se produit.
Ces règles précèdent ChatGPT. Depuis l’entrée de l’IA générative dans l’usage public il y a un an, le sol sous la découvrabilité a bougé. Ce qui semblait être les bonnes questions n’est plus aligné avec une réalité nouvelle et changeante à grande vitesse.
Et il ne s’agit pas seulement d’un enjeu pour les arts. Les universités, les OSBL, les entreprises et même les gouvernements continuent d’orienter leurs efforts autour de la découvrabilité en ligne comme si c’était l’enjeu stratégique. Or la découvrabilité est tactique, pas stratégique.
Elle offre une visibilité à court terme, mais ne répond pas à la question de fond: qui détient l’autorité lorsque les systèmes d’IA décident ce qui est vrai?
Depuis vingt ans, les organisations agissent comme si certaines hypothèses tenaient toujours:
- Nous pensions que le contenu était roi. La réalité aujourd’hui est que le contenu est abondant.
- Nous pensions que la découvrabilité était l’objectif. La réalité aujourd’hui est que la découvrabilité crée de la dépendance.
- Nous pensions que l’optimisation nous donnerait du pouvoir. La réalité aujourd’hui est qu’elle ancre la dépendance.
- Nous pensions que la visibilité se gagnait au mérite. La réalité aujourd’hui est qu’elle est allouée par des algorithmes.
- Et ces algorithmes sont conçus par des entreprises commerciales pour servir leurs objectifs d’affaires, généralement le profit, et non les besoins des artistes, des communautés ou du public en général.
Les géants du numérique profitent de cette incompréhension. Plus nous traitons la découvrabilité comme le problème, plus nous leur fournissons du travail gratuit, en structurant notre contenu pour nourrir leurs systèmes tout en approfondissant notre dépendance.
La question ne peut plus être « Comment se faire voir? ». La question doit désormais être « Comment rester autoritatifs? ».
L’optimisation est une épée à double tranchant. D’un côté, elle semble offrir des gains: un meilleur classement, plus de clics, une impression fugace de visibilité. De l’autre, chaque ajustement vous attache un peu plus à la logique de la plateforme. Les organisations se tiennent occupées à courir après chaque changement d’algorithme, à réécrire du contenu, à modifier des balises, à mettre des sites à jour, toujours en train d’essayer de suivre. À chaque mise à jour, les critères se déplacent. Plus vous travaillez pour servir le système, plus le système se renforce et plus votre propre autorité s’affaiblit. Ce qui ressemble à des progrès n’est en réalité qu’une dépendance déguisée. Ce n’est pas une erreur. C’est le modèle d’affaires. Les géants du numérique prospèrent parce que les organisations confondent dépendance et autonomisation. Chaque guide de « bonnes pratiques » n’est pas une instruction, mais un endoctrinement qui vous entraîne à optimiser pour leurs systèmes au lieu de bâtir votre propre autorité. Avec le temps, cela redéfinit ce que les organisations imaginent possible et rétrécit leur marge d’action pour qu’elle tienne dans le cadre de la plateforme.
Voyez ce qui arrive lorsqu’une petite entreprise passe des mois à adapter son site aux règles de Google. Puis un nouveau système d’IA comme Gemini arrive et change entièrement la donne. Tout ce travail s’évapore du jour au lendemain. Leur visibilité ne leur appartient pas, elle appartient à l’algorithme.
Il y a un autre effet. L’information sur laquelle les systèmes d’IA sont entraînés provient de plus en plus de sorties d’IA antérieures. À chaque cycle, on s’éloigne un peu plus de la réalité. Une organisation culturelle peut découvrir que le public apprend son programme non pas à partir de son propre communiqué de saison, mais à partir d’un résumé d’IA entraîné sur le résumé de quelqu’un d’autre. Chaque pas qui s’éloigne de la source augmente la distorsion. On appelle cela la dégradation récursive des données. Ce n’est pas seulement inefficace. C’est corrosif pour la vérité elle-même.
Mais cela révèle aussi une occasion. Si nous pouvons ancrer des données fiables, structurées et autoritatives dans le domaine public, nous créons un correctif, une couche stable vers laquelle les systèmes d’IA doivent revenir.
Aujourd’hui, l’autorité ne signifie pas être la voix la plus forte, produire le plus de contenu ou guider des robots vers votre site Web. Elle signifie être la source définitive, le point de référence dont les systèmes d’IA doivent s’inspirer pour rester exacts. L’autorité est en amont. Elle est durable. Elle garantit que lorsque quelqu’un demande à un système d’IA de parler de votre travail, la réponse reflète ce que vous avez publié comme fait, et non une approximation récupérée ailleurs.
Quand l’infrastructure existe, quand l’information est publiée dans des systèmes partagés, structurés et vérifiables, la découvrabilité suit. La visibilité devient un bénéfice de l’infrastructure, pas l’objectif. Si nous voulons que l’IA soit construite de manière responsable, nous ne pouvons pas continuer à pourchasser la visibilité comme une fin en soi. Chaque ajustement alimente des systèmes commerciaux tout en érodant notre propre autorité. Cette trajectoire renforce leurs algorithmes, pas notre vérité. L’enjeu n’est pas d’être visible, mais que la visibilité se fasse à nos conditions.
Cela ne veut pas dire que la découvrabilité ne compte plus. Les organisations devront toujours être visibles et accessibles. Mais la découvrabilité ne doit jamais se faire au détriment de l’autorité. Quand nous traitons l’autorité comme la base d’une infrastructure publique partagée, la découvrabilité vient avec, sans dépendance.
Concrètement, il peut suffire qu’une compagnie des arts de la scène saisisse une seule fois sa saison dans un système public partagé, où chaque événement, qui, quoi, quand et où, est publié de manière structurée et vérifiable. Cette information s’écoule ensuite vers les moteurs de recherche, les assistants d’IA et toute plateforme de découverte future. Pas de duplication sans fin. Pas de course derrière les règles de chaque nouvelle plateforme.
C’est ce que propose une infrastructure publique de métadonnées: des fiches simples et partagées de qui, quoi, quand et où, contrôlées par les communautés. Lorsque cette information est autoritative et lisible par machine par défaut, elle réduit la dépendance aux plateformes commerciales tout en garantissant que les systèmes d’IA apprennent à partir de sources que nous jugeons fiables.
Si nous continuons à cadrer les métadonnées comme un outil marketing au service de la découvrabilité, nous orienterons la gouvernance et la stratégie vers des besoins tactiques et nous resterons prisonniers de systèmes commerciaux. En ce moment, les plus grandes entreprises du monde se disputent le contrôle de la couche de connaissances. Une infrastructure publique de métadonnées offre une voie de sortie. Elle exige des systèmes partagés que les communautés peuvent gouverner ensemble, afin de bâtir une autorité qui préserve la vérité culturelle, la capacité civique d’agir et la résilience démocratique, peu importe la plateforme commerciale qui monte ou qui décline.
Cette infrastructure est agnostique aux plateformes. Des données structurées et autoritatives peuvent circuler dans n’importe quel système, Google, ChatGPT, Gemini, Perplexity ou des plateformes à venir. Voilà l’essentiel: l’autorité traverse les systèmes, alors que les tactiques de découvrabilité doivent être réinventées à chaque changement de paysage.
Le génie est sorti de la bouteille. Nous ne reviendrons pas à un Web pré-IA. Nous pouvons toutefois décider de demeurer coincés dans la dépendance ou de bâtir une autorité qu’aucun système ne peut ignorer. La bonne nouvelle est qu’une solution existe déjà et, contrairement aux milliards investis dans l’IA commerciale, une infrastructure publique de métadonnées ne coûte pas cher. C’est un investissement modeste aux effets générationnels.